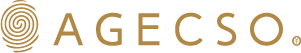Projet BourbaKeM
Elément n°15
Philosophie de la connaissance
Emmanuel Bonnet
[Version PDF du texte]
1. Introduction : trois éléments de repérage
L’objet de cette contribution est d’introduire certaines questions associées à la philosophie de la connaissance. Ce champ d’investigation philosophique est très vaste et porte sur la nature, les sources et les limites de la connaissance (Dutant et Engel, 2005 ; Nagel, 2014). Il s’agit par exemple de définir la nature de la connaissance, de déterminer les conditions de notre connaissance du monde extérieur, de préciser les modalités de justification de nos croyances, ou encore de savoir comment conduire nos pensées pour échapper à l’erreur (Chevalier et Gaultier, 2014). La philosophie de la connaissance renvoie ainsi à des questions fondamentales, constantes dans l’histoire de la philosophie, que cette contribution n’aborde que partiellement. Ne pouvant prétendre à un exposé exhaustif des courants philosophiques autour de ces questions, nous proposons trois éléments de repérage pour s’orienter dans la philosophie de la connaissance (diapo 2).
(i) La définition de la connaissance et les modalités de justification des croyances
(ii) Les sources de la connaissance relative au sujet connaissant
(iii) Les conséquences pratiques de la connaissance, c’est-à-dire la question du lien entre la connaissance et l’action
Cette formulation classique en trois parties proposées ici, souligne trois finalités distinctes de l’enquête philosophique autour de la connaissance :
(i’) une certitude épistémique basée sur des croyances vraies et justifiées
(ii’) une certitude subjective associée à la conscience réflexive du sujet connaissant
(iii’) une certitude (ou une garantie) pratique pour laquelle il ne s’agit plus de justifier nos croyances, ni d’avoir une conscience indubitable de certaines vérités, mais d’établir une « garantie » qui nous dispose à agir.
Dans cette contribution, le premier élément renvoie à la philosophie de Platon et se prolonge dans la philosophie analytique contemporaine. Pour le second, il s’agit de la « voie des idées » dans la philosophie classique qui oppose le rationalisme de René Descartes et l’empirisme de John Locke et de David Hume. Enfin pour le dernier, c’est la philosophie pragmatiste de John Dewey qui nous offre une perspective de dépassement de certains dualismes anciens et classiques.
2. Qu’est-ce que la connaissance ?
2.1. La philosophie contemplative de la connaissance de Platon
Depuis les philosophes présocratiques, la connaissance est l’expression de la force de la raison (logos). La connaissance humaine est le produit d’une activité d’abord fondée sur des objets intelligibles, par exemple des axiomes et des théorèmes, qui transcendent les changements et la contingence associés au monde sensible. Dans cette démarche purement intellectuelle, la connaissance est une quête de vérité absolue. Platon cherche la vérité à partir d’un dialogue entre un dialecticien et un répondant. Seul le dialogue peut être le mode d’expression de la pensée. De ce point de vue, la connaissance de la vérité ne s’enseigne pas par l’écriture qui fige la pensée mais par le dialogue qui résiste au caractère dogmatique des opinions reçues, selon un célèbre adage attribué à Socrate « Je sais qu’une chose c’est que je ne sais rien ». Le dialogue est un espace de tensions et d’échanges de questions et de réponses, de brefs propos, qui orientent les « prétendants à la vérité » (Brague, 1999) vers une finalité qui les dépasse. La vérité, objet ultime de la connaissance, a quelque d’étrange et d’invisible pour ceux qui la cherchent. La philosophie platonicienne de la connaissance nous oriente vers la contemplation de l’intelligible, et paradoxalement ce que l’on cherche à contempler est invisible.
Dans le mythe de la caverne du Livre 7 de La République (Diapo 3), des hommes sont depuis leur naissance enchaînés au fond d’une caverne. Dans l’obscurité, ils ne perçoivent que les ombres projetées par d’autres personnes qui ne sont pas enchaînées et qui vivent dans la caverne derrière un petit mur. Ils portent des objets sur la tête. Avec ce dispositif « cinématographique » les ombres des objets sont projetées sur la paroi. Un des prisonniers se libère de ses chaînes pour sortir de la caverne et remet en question sa servitude aux ombres projetées. Ce que signifie cette allégorie, c’est que nous sommes déterminés par des images (eidola) et des fictions (phantasmata) que nous percevons depuis notre naissance mais qui nous ne permettent pas d’accéder à la réalité. Il y a un dualisme entre le monde sensible et les formes intelligibles. Le monde dans lequel vivent les humains est un monde sensible et trompeur. Pourtant l’un d’entre eux se sent étranger à sa condition et cherche à se détacher de l’expérience immédiate qu’il a du monde. L’hypothèse métaphysique de cette allégorie est que le visible – l’apparence des ombres mouvantes et projetées – est produit par une réalité invisible et immuable. La question fondamentale à propos de la connaissance est de savoir comment on remonte du visible à l’invisible, du mouvement à l’immuable, de l’apparence au réel. L’enjeu pour la connaissance est de contempler avec « l’œil de l’âme » les vérités plutôt que les images sensibles. Cette remontée du visible vers l’invisible est le mouvement de l’intelligence, qui se divise en deux types d’activités : l’activité discursive (dianonia) qui porte sur des réalités mathématiques et la contemplation (theôria) qui porte sur les idées, c’est-à-dire sur les formes intelligibles qui sont la source de tout ce qui est.
2.2. La connaissance est-elle une croyance vraie justifiée ?
Dans le Théétète (189a-192c) de Platon, la connaissance est définie comme une opinion vraie « pourvue de raison » (logos). L’opinion est un mode de connaissance qui se distingue de l’ignorance pure et simple – qui est sans objet – et de l’intelligence – qui porte sur ce qui est. L’opinion porte sur les apparences, sur ce qui « paraît être » (Ménon, 85b-86b) se rapprochant ainsi de la notion de croyance. Le philosophe Edmund Gettier (1963) reformule cette définition de la façon suivante (dans laquelle S renvoie à un sujet, P à une proposition) : S sait que P si et seulement si (i) S croit que P, (ii) P est vrai, et (iii) S est justifié à croire que P. C’est un court article de seulement trois pages « Is justified true belief knowledge ? » (Gettier, 1963) qui est le point de départ d’une controverse dans la philosophie de la connaissance contemporaine. Le « problème de Gettier » est relatif à des cas pour lesquels le fait d’avoir une croyance vraie et justifiée – c’est-à-dire raisonnable et/ou soutenue par des preuves empiriques – ne suffit pas pour avoir une connaissance. Prenons le cas suivant : « Supposez qu’un policier vous demande si vous avez votre passeport sur vous. Vous êtes confiant de l’avoir, et cette croyance est justifiée, parce que vous avez l’habitude de le conserver sur vous. Elle est également vraie : le passeport est bien là. Mais à votre insu, un pickpocket très habile vous l’a dérobé, et, n’y trouvant pas l’argent qui l’intéressait, a trouvé le moyen de le remettre dans votre poche. Savez-vous que vous avez votre passeport ? Il semble que non. Votre croyance a beau être justifiée, elle n’est vraie que par hasard : le portefeuille aurait pu être absent, vous ne l’auriez pas remarqué. » (Dutant et Engel, 2005, pp. 13-14). Platon avait déjà évoqué le cas des croyances vraies par hasard (les opinions ne l’emportent pas sur l’intelligence).
Deux conséquences du « problème de Gettier » sont à souligner. D’abord la connaissance est quelque chose de plus que la simple association de la justification et de la croyance vraie. Ensuite, ce problème fait naître deux positions théoriques autour de la justification des croyances : l’internalisme et l’externalisme. L’internalisme est la thèse selon laquelle le sujet a accès à ses propres justifications. L’externalisme est la thèse selon laquelle la justification n’est pas liée à un accès interne du sujet, et qu’il faut plutôt chercher les causes en dehors dans le monde (naturel et/ou social), la vérité étant extérieure au sujet connaissant (Dutant et Engel, Ibid. p. 18-21). Notons pour finir que la définition de départ, contestée par Gettier, de la connaissance comme croyance vraie justifiée, concerne uniquement la connaissance dite « à propos de quelque chose », c’est-à-dire la connaissance de la « nature interne des faits » que l’on distingue de connaissances des choses avec lesquelles nous interagissons quotidiennement (James, 1890). Sur cette base, Bertrand Russell, distingue la connaissance propositionnelle, c’est-à-dire à propos de que quelque chose (knowing about et knowledge by description), de la connaissance directe et intuitive que nous avons notamment dans la pratique e.g. savoir comment nager (knowing how et knowledge by acquaintance) (Russell, 1914/2002).
3. Les sources de la connaissance : la « voie des idées »
3.1. Une « révolution copernicienne » dans la philosophie de la connaissance.
La philosophie classique de la connaissance est parfois associée à un « déplacement épistémique » passant du langage de l’ontologie au langage des idées, du langage des objets physiques au langage de l’esprit humain : les apparences perçues ne sont plus fondées sur une réalité immuable extérieure à l’esprit : « les perceptions sont les objets » (Yolton, 2000, p.3). Dans l’esprit il y a des idées i.e. des entités mentales et non des choses i.e. des entités physiques. De ce point de vue, le fondement de la connaissance n’est autre que le sujet. C’est le programme de la philosophie classique jusqu’à Kant (1781) qui évoque une « révolution copernicienne » à l’égard de la connaissance : « Les objets se règlent sur notre connaissance » (Seconde préface de la Critique de la raison pure). En se basant sur l’analogie de la rotation de la terre autour du soleil, Kant dit que l’objet de la connaissance gravite autour du sujet connaissant et non l’inverse. Cette révolution copernicienne est débutée par Descartes avec l’importance accordée aux idées que l’esprit trouve en lui-même. Ces idées ne renvoient pas à une réalité immuable et invisible (Platon) mais à ce que l’esprit possède en lui-même. La philosophie de la connaissance dépend ainsi d’une réflexion que l’esprit opère sur lui-même. L’idée n’est plus une forme intelligible qui transcende le monde sensible mais la manière dont les choses existent dans l’esprit. Dans la philosophie classique de la connaissance, que l’on soit rationaliste ou empiriste, il y a un primat des idées. En d’autres termes, l’épistémologie des idées précède l’ontologie des choses physiques. C’est la « la voie des idées » qui sera le fil conducteur de la discussion entre les philosophes rationalistes et empiristes.
3.2. Le rationalisme de Descartes
Pour Descartes, la tâche de la philosophie est la connaissance de l’esprit humain et de son pouvoir de connaître : « Nous ne pouvons avoir aucune connaissance des choses que par les idées que nous en concevons ; et par conséquent, nous n’en devons juger que suivant ces idées, et même nous devons penser que tout ce qui répugne à ces idées est absolument impossible, et implique contradiction. » (Lettre XLI, à un révérend Père de l’oratoire, Docteur de Sorbonne). L’idée est «comme une image des choses » (Méditation Troisième), une représentation de quelque chose, sans laquelle nous ne pouvons rien connaître. L’ambition du rationalisme de Descartes est de constituer une science universelle qui dépasse la division des disciplines : produire une mathesis universalis (savoir universel). Cette connaissance porte sur l’ordre i.e. la progression du simple au complexe, et la mesure i.e. le pouvoir de donner un résultat exact. Un corps matériel n’est rien d’autre que ce que l’on peut mesurer e.g. son poids, sa taille. D’un côté, il y a la nature matérielle que l’on peut mesurer et de l’autre les idées que l’on ne peut pas mesurer. On trouve ici un autre dualisme entre deux ordres irréductibles l’un à l’autre : les corps étendus et les idées de l’esprit. Descartes donne ainsi une direction à la philosophie de la connaissance qui tient compte des spécificités l’esprit : c’est la « voie des idées » c’est-à-dire de la connaissance des opérations de l’esprit. L’expérience sensible n’est pas un matériau pour Descartes mais une occasion pour l’esprit d’activer les idées qu’il possède déjà en lui-même. Le rationalisme de Descartes connaîtra un développement avec la philosophie de Kant (1781). Même si Kant n’a jamais développé à proprement parler une philosophie de la connaissance, il partage avec Descartes, non pas la thèse que les idées qui précédent l’expérience, mais que les formes de l’entendement, les catégories sont « des manières pour l’esprit humain d’ordonner le divers donné dans l’intuition. ». Sans l’intuition sensible, l’esprit ne peut rien connaître. En ce sens, Kant s’accorde également avec la thèse qui fonde l’empirisme classique, thèse selon laquelle : « Toute notre connaissance commence avec l’expérience » (Critique de la Raison Pure, Introduction).
3.3. L’empirisme de Locke et Hume
Les philosophes empiristes classiques privilégient l’expérience sensible sur la rationalité par exemple la déduction ou la logique, mais restent en accord avec le mouvement de la « voie des idées » : la raison n’est pas dans les choses mais dans l’esprit. Mais il s’agit, contrairement au rationalisme, de vider l’esprit des idées préexistantes pour le remplir d’impressions sensibles. On ne peut pas connaître l’essence des choses, c’est-à-dire ce que sont les choses en elles-mêmes. On ne connaît que les phénomènes, les choses telles qu’elles nous apparaissent. Les théories de la connaissance empiristes sont ainsi fondées sur la limitation de la connaissance à l’entendement et à l’esprit humain. La connaissance humaine est enracinée dans l’expérience ordinaire, et in n’y a pas d’«essence » immuable des objets connaissables. L’expérience devient ainsi la seule source de nos connaissances. C’est le principe de la table rase que l’on retrouve chez Locke « (…) au commencement l’âme est ce qu’on appelle une table rase, vide de tous caractères, sans aucune idée » autrement dit « il n’y a rien dans l’esprit qui ne fut d’abord dans les sens » (Locke, L’essai sur l’entendement humain, 1689). L’empirisme procède à une critique de l’innéisme : les idées ne sont pas innées mais acquises. Les manières de connaître dépendent moins des objets que des sujets, c’est-à-dire des sensations qui donnent une orientation singulière à la connaissance. Ici la philosophie de la connaissance opère aussi un déplacement en termes de finalité, la quête d’une certitude subjective n’est plus orientée uniquement sur l’activité interne d’un sujet réflexif, mais vers les activités humaines dans la vie ordinaire.
Pour David Hume (Enquête sur l’entendement humain, 1748), l’esprit humain ne peut connaître ou apprendre que ce qu’il a intérêt à connaître. L’homme ne connaît pas comme un spectateur neutre, isolé et impartial et il ne cherche la vérité dans la mesure ou cette vérité peut compter dans sa vie ordinaire. Il ne peut connaître que ce qui le concerne et ce qui le touche subjectivement. L’homme a une destination pratique. Si « tout homme par nature désir connaître » (Aristote, Métaphysique), il désire connaître non pas pour découvrir l’essence des choses mais pour être heureux. La philosophie de la connaissance empiriste cherche à dépasser la métaphysique pour s’accorder davantage avec les intérêts pratiques de la vie humaine. La connaissance sert la vie humaine plutôt que des finalités spéculatives. L’activité de connaître repose et engendre des habitudes qui facilitent la transition d’une chose à une autre. Il y a bien une quête de certitude dans l’empirisme, non pour justifier une croyance mais pour justifier nos manières de vivre et d’agir. La connaissance de l’objet dépend de la connaissance du sujet et la finalité de la connaissance dépend de l’intérêt de l’homme à connaître. Le sujet de la connaissance n’est pas un être purement contemplatif (Platon) ou réflexif (Descartes), c’est un être actif qui transforme le monde par l’activité régulatrice de l’esprit, plutôt qu’en imposant ses certitudes (Hume).
4. La philosophie pragmatiste de John Dewey
Dans les traditions antérieures, anciennes (métaphysiques) et classiques (empirisme et rationalisme), la philosophie de la connaissance cherche à être infaillible et certaine. L’infaillibilité est l’impossibilité de se tromper ou la garantie du vrai. La certitude est la marque de la vérité : ce qui fait que l’on peut tenir une croyance pour vraie. Soit on possède individuellement ce critère, et c’est la présence réflexive en nous qui est la marque du vrai soit on ne le possède pas et il faut le chercher ailleurs. Pour les empiristes ce critère est au niveau des impressions sensorielles qui sont aussi certaines que les « idées claires et distinctes » de Descartes. Pour le philosophe pragmatiste John Dewey, la justification n’implique pas la vérité. On doit les séparer (comme pour Gettier). Dewey parle d’assertabilité garantie plutôt que de justification.
La connaissance n’est pas une activité subjective, réflexive ou un état mental (spectator theory of knowledge) c’est un processus d’enquête orienté sur la transformation d’une situation plutôt que sur la contemplation d’un objet : « Nous connaissons quand nous connaissons effectivement, c’est-à-dire quand notre enquête conduit à des conclusions qui règlent le problème dont elle procède. » (La quête de certitude, p. 214) : « si nous voyons que le connaître n’est pas l’acte d’un spectateur se tenant en dehors de la scène naturelle et sociale mais l’acte d’un participant, alors le véritable objet de la connaissance se situe au niveau des conséquences de l’action dirigée. (…) Le résultat d’une opération quelconque sera un objet de connaissance aussi bon et vrai que tout autre objet, pour autant qu’il soit bon au sens où il satisfait les conditions qui ont induit l’enquête. (…) On pourrait aller jusqu’à affirmer qu’il existe autant de genres de connaissances valides, qu’il y a de conclusions pour le bénéfice desquelles on a employé des opérations distinctes dans l’idée de résoudre des problèmes ayant surgi au sein de situations dont a fait antérieurement l’expérience. (Ibid. p. 212-213). La définition traditionnelle de la connaissance comme contemplation se fondait implicitement ou explicitement sur la notion de représentation, ce qui la prive « de sa fonction active et créatrice (car) son rôle est de simplement reproduire, de re-présenter symboliquement, de considérer une structure rationnelle donnée. (…) Elle a relégué la production (making) et l’action (doing) pratique dans un domaine secondaire et relativement irrationnel. » (Ibid. p. 227). Dans la doctrine traditionnelle, la participation active de l’homme dans l’élaboration de connaissances était considérée comme un biais, une distorsion affectant ces lois immuables alors que « L’intervention humaine destinée à la réalisation n’est aucunement une interférence ; c’est un moyen de la connaissance. » (Ibid. p. 228).
La notion d’enquête est empruntée à Charles Sanders Peirce qui désigne par ce terme toute activité de pensée provoquée par un doute éprouvé et se concluant par la fixation d’une croyance disposant à l’action. On ne pense pas pour rien, « pour le plaisir, mais pour calmer l’irritation d’un doute » (Madelrieux, 2016, p. 114) : lorsqu’une croyance est fixée et qu’une action en découle, la pensée a atteint sa fin. L’enquête présente deux dimensions : temporelle et progressive. Il y a un déroulement par étape et une transformation de la situation initiale à laquelle est associée un problème pratique, qu’il soit du registre scientifique ou du sens commun (Dewey, 1938). Il s’agit pour Dewey de dégager un « schème commun ; que cette structure commune s’applique au sens commun et à la science » (1938, p. 101). La connaissance est une œuvre, c’est-à-dire le résultat d’une production et d’une transaction ordinaire entre un organisme et son environnement. La connaissance comme produit peut également être formative, c’est-à-dire « régler la propre conduite des activités » dont elle est issue. La connaissance est donc un « moyen opératoire » pour ceux qui sont engagés dans des transactions ordinaires. La connaissance comme processus d’enquête présente une dimension instrumentale, c’est le développement d’un pouvoir d’action sur la situation qui affecte le déroulement de l’enquête. Il y a bien un terme à l’enquête qui est l’instauration d’un nouvel équilibre dans une situation indéterminée. L’enquête n’est donc pas un processus permanent de transformation.
5. Remarques conclusives
Cette contribution proposait d’aborder la philosophie de la connaissance à partir de trois éléments de repérage, suscitant un certain nombre de positions et de controverses entre différents courants philosophiques. Notre objectif ne consistait pas ici à évaluer les différentes réponses apportées à ces questions, mais à souligner leur évolution. La philosophie de la connaissance n’est pas un corpus de doctrines figées et d’arguments mais un mouvement dont le but ne consiste plus dans la quête infinie de certitudes ultimes, de fondements, mais à imaginer des situations a venir qui calment les troubles associés à la vie humaine. Le pragmatisme montre en particulier que les fondements et le périmètre de la philosophie de la connaissance traditionnelle sont trop restreints pour nous orienter sur de nouvelles formes d’enquêtes. Il s’agit plus radicalement de réévaluer le concept de connaissance et nos manières de produire des connaissances.
6. Bibliographie sélective
Descartes (1937) Œuvres et lettres, La pléiade.
Dewey (1929/2014) La quête de certitude. Une étude de la relation entre connaissance et action. Gallimard.
Hume, D., (1748/2008) Enquête sur l’entendement humain, Vrin.
Kant, (1781/1993) Critique de la raison pure, Presses Universitaires de France.
Locke, J., (1689/2006) Essai sur l’entendement humain (Livres1-4) Vrin.
Platon, Ménon, Flammarion.
Russell, B., (1914/2002) Problèmes de philosophie, Payot.
Chevalier, J-M., et Gaultier, B., (Sous la dir.) (2014) Connaître. Questions d’épistémologie contemporaine. Ithaque
Dutant, J., et Engel, P., (Textes réunis par) (2005) Philosophie de la connaissance. Croyance, connaissance, justification. Vrin.
Nagel, J., (2014) Knowledge. A Very Short Introduction. Oxford University Press.
7. L’auteur
E mmanuel Bonnet est enseignant-chercheur au Groupe ESC Clermont et au Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management. Ses recherches portent principalement sur les dynamiques collectives d’apprentissage dans les projets innovants qui accordent une place importante à l’exploration. Il a participé dans le cadre de sa thèse à une simulation d’exploration martienne dans le désert de l’Utah (USA). Les pratiques quotidiennes des membres d’équipage ont été décrites comme une enquête (Dewey, 1938). Emmanuel a effectué une recherche postdoctorale à l’INRA qui porte sur de nouvelles formes d’apprentissage dans des collectifs agroécologiques
mmanuel Bonnet est enseignant-chercheur au Groupe ESC Clermont et au Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management. Ses recherches portent principalement sur les dynamiques collectives d’apprentissage dans les projets innovants qui accordent une place importante à l’exploration. Il a participé dans le cadre de sa thèse à une simulation d’exploration martienne dans le désert de l’Utah (USA). Les pratiques quotidiennes des membres d’équipage ont été décrites comme une enquête (Dewey, 1938). Emmanuel a effectué une recherche postdoctorale à l’INRA qui porte sur de nouvelles formes d’apprentissage dans des collectifs agroécologiques