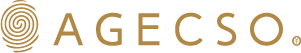Projet BourbaKeM
Elément n°8
Le transfert des connaissances
Claude Paraponaris[1]
[Version PDF du texte]
[Version Powerpoint]
1. Introduction
Le transfert des connaissances est régulièrement présenté dans les études économiques et les politiques publiques comme un levier de compétitivité. Dans les années 60, il était question de transfert de technologie des pays du Nord vers les pays du Sud, puis de transfert entre filiales des firmes multinationales. Le sujet du transfert est souvent présent dans le monde des ingénieurs et techniciens, dans l’univers des relations entre science et industrie, chez les sportifs et les artistes et dans le domaine éducatif.
Pourtant les difficultés que rencontre ce transfert des connaissances sont nombreuses et particulièrement sérieuses. Les obstacles au transfert reposeraient sur un manque de motivation des personnes, notamment des salariés, ou sur un manque de confiance (Cabrera et Cabrera, 2002, Lewine et Cross, 2004). Comme si, en fait, le transfert des connaissances ne se suffisait pas à lui-même et devait emprunter des pratiques finalement assez classiques de management. Un constat plus ancien nous met en fait sur la voie d’une autre explication. Dans une étude réputée, Szulanski (1996) met en évidence les facteurs qui peuvent limiter le transfert des connaissances au sein d’une organisation : le manque de capacité d’absorption du destinataire, l’ambiguïté causale et une relation difficile entre la source et le destinataire.
Le transfert des connaissances ne peut pas être simplement assimilé à une question de flux. Il doit prendre en compte quelques dimensions assez simples que nous allons étudier. Au cours du transfert, l’émetteur et le récepteur ne sont pas accordés sur les termes de leur communication, cette communication (au sens d’action commune) fait souvent référence à de nombreux objets qui sont, chacun, animés par des projets plus ou moins conciliables.
De ce fait, si l’on comprend bien les enjeux d’un transfert des connaissances dans une visée économique, sociale, éducative ou politique, on doit toutefois user de prudence afin de définir les termes du transfert. L’expérience tendrait à prouver que l’on a sous-estimé le rôle du destinataire. S’il s’agit de permettre le partage d’une expérience particulièrement riche d’enseignement, il faut alors soigneusement définir les moyens de ce partage et ses possibles conséquences.
Nous présentons la problématique du transfert en quatre points : son intérêt et ses enjeux économiques, deux méthodes de transfert particulièrement éclairantes élaborées par de grands spécialistes à propos des moyens investis et des conditions du transfert, les dimensions organisationnelles et enfin les perspectives du transfert des connaissances.
2. Intérêt et enjeux
2.1. Un intérêt grandissant
Le transfert des connaissances constitue un sujet d’intérêt qui s’est développé de manière exponentielle au cours des dernières décennies. Il s’est développé avec de nouveaux modèles économiques et donc de nouvelles manières d’organiser les activités : management par projets qui met en tension les métiers et les techniques, stratégies d’innovation qui ont tendance à invalider rapidement les technologies et les compétences, restructurations d’entreprise et destructions d’emploi qui menacent la pérennité des savoir-faire, internationalisation rapide des affaires qui exige une disponibilité immédiate des technologies et donc des connaissances. Sont ainsi apparues de multiples expériences de transfert :
- pour faciliter la prise de fonction des jeunes recrues dans l’entreprise en mettant à disposition des documents informés par le vécu professionnel des employés experts dans leur domaine,
- pour simplifier le démarrage d’un nouveau projet et bénéficier de l’expérience accumulée par les projets antérieurs,
- pour optimiser le partage des connaissances au sein d’une firme multinationale qui dispose de multiples filiales et qui s’expose à la fuite de ses technologies vers d’autres agents économiques,
- pour rendre possible l’innovation en prenant appui sur les patrimoines de connaissances (cf.
J-L Ermine, « Le patrimoine de connaissances d’une organisation », BourbaKeM, Elément n°1) possédés en propre ou développés au sein de centre de ressources académiques ou techniques.
2.2. Le transfert des connaissances comme défi stratégique
Transférer des connaissances est ainsi devenu une action stratégique qui intervient particulièrement pour réussir une alliance entre plusieurs firmes, transmettre des connaissances scientifiques à des PME qui ne disposent pas de capacités de R&D, assurer le partage de l’expérience entre filiales d’une firme multinationale ou plus généralement pour faciliter la diffusion des savoir-faire entre plusieurs organisations.
Le transfert a été abondamment étudié dans les situations de transition stratégique : par exemple dans le cas des alliances. Pour ces stratégies, la capacité de réévaluation des situations et d’apprentissage de l’expérience du rapprochement de deux entités est présenté comme un facteur de réussite important (Inkpen, 1996; Doz, 1996; Mowery, 1998).
D’autres situations de transition ont permis d’approfondir ces analyses. Bresman (1999) analyse le transfert dans les situations d’acquisition internationale : la firme est analysée comme un ensemble de communautés professionnelles (Cf. P. Cohendet « Les communautés de connaissances » BourbaKeM, élément n°6) et la question posée est celle des meilleures structures pouvant autoriser le transfert entre elles. Les moyens qui facilitent le transfert sont les suivants : la communication en face à face, les visites et réunions entre partenaires, la codification (brevets et littérature grise), il est précisé que le temps a tendance à améliorer le transfert.
Les dimensions sociales et organisationnelles des connaissances sont posées comme facteurs déterminants et on s’interroge sur les meilleurs moyens de faciliter l’intégration des connaissances au sein d’une organisation. Pour cela, deux grandes voies sont empruntées : celle du design organisationnel en s’interrogeant à propos des capacités d’intégration formelle de l’organisation, et puis celle des réseaux et du capital social qui considèrent que les liens entre les personnes sont plus importants que les structures formelles d’une organisation (Gulati, 2000, Nahapiet et Ghoshal, 1998).
Le design organisationnel représente une préoccupation majeure chez les dirigeants d’entreprise et les consultants. C’est par exemple une multinationale allemande qui organise le transfert au moyen d’un système sociotechnique puissant. D’une part, un système intranet (le troisième plus important au monde) relie 160.000 employés au travers de plusieurs dizaines de filiales, et d’autre part, des incitations très fortes à la mobilité des techniciens de courte et moyenne durée afin de faciliter le transfert des compétences, des connaissances et de l’expertise. Dans ce cas, le transfert ne peut pas s’assimiler à une simple transmission d’informations. Il s’agit de regrouper un système d’information efficient et un système de relations variées et fréquentes entre employés.
Selon l’approche en termes de réseau et de capital social, il existe des situations et des réseaux de relations. Les situations fournissent l’occasion d’activer ces relations qui présentent l’opportunité d’accéder à des connaissances de différent type (commerciales, techniques, sociales).
Le transfert devient une affaire de structure du capital social du réseau auquel on s’intéresse. La qualité des liens entre membres du réseau ou entre différents réseaux est envisagée comme une source féconde de recherches. En particulier, le capital social individuel est défini comme le niveau le plus pertinent pour suivre le transfert de connaissances tacites.
On s’intéresse aux dimensions des réseaux qui sont structurelles, cognitives et relationnelles.
Les structures d’un réseau désignent l’autorité (degré de centralisation) et la stabilité de ses membres. Les transferts de connaissance se réalisent plus facilement lorsque les membres sont stables et autonomes dans leur pratique de communication et lorsque l’autorité est décentralisée.
La dimension cognitive d’un réseau désigne la vision et les buts collectifs de l’organisation. Par exemple, dans le cas d’une firme internationale : que les différentes cultures s’accommodent les unes les autres.
Enfin la dimension relationnelle s’intéresse aux risques de malentendu entre personnes, risques qui doivent être contenus en développant un système clair d’incitations.
Dans ces approches deux constats s’imposent : les contextes de communication sont déterminants, et la question du transfert est placée au cœur de la dynamique des organisations.
Mais de ce fait, nous ne sommes pas très instruits sur le processus de transfert : comment se déroule-t-il en pratique et quelles sont les ressources qui sont engagées ? Il faut compléter l’approche en passant du défi à la mise en œuvre du transfert.
3. Les méthodes de transfert
La panoplie des méthodes de transfert des connaissances est très développée. On peut en dénombrer plusieurs dizaines (Dieng, 2000). Nous avons choisi d’en présenter deux en raison de leur robustesse conceptuelle et de leur prudence quant aux effets produits. Le marché des outils de gestion est en effet foisonnant et il n’est pas rare de se trouver aux prises avec des offres de prestation qui n’intègrent pas toutes les dimensions de l’apprentissage qui sont précisément en jeu à l’occasion d’un projet de transfert des connaissances.
3.1. La méthode 3A : Méthode d’Analyse Autonome des Activités
Cette méthode est proposée par un spécialiste de psychologie cognitive qui a réalisé de nombreuses missions dans l’industrie : Jean-Pierre Poitou (1996).
*
Plusieurs principes président à la conception et à l’usage de cette méthode.
Les connaissances s’objectivent dans des dispositifs matériels (machines, méthodes, outils, …). De ce fait l’activité humaine se développe le plus souvent avec ces dispositifs. « L’outil est la science extériorisée du geste. Il n’est pas seulement le support occasionnel d’une certaine efficience neuro-motrice, il est un objet intellectuel, dépôt de connaissances, qu’il transforme en action lorsque les conditions de sa mise en œuvre sont réunies. Il actualise une mémoire en une pensée agissante » (Poitou, 1996, p.4).
Les connaissances sont gérées dans des formations dialogiques hommes-machines. C’est-à-dire que ni le fonctionnement cognitif isolé de l’homme d’un côté, ni celui de la technique de l’autre, n’ont de sens. C’est davantage de dispositif cognitif dont il faut parler. Ce dispositif rassemble de manière très interactive l’humain, son langage, son outillage, ses méthodes de travail et sa formation technique.
Les relations entre hommes et machines sont mutuellement structurantes, et non pas établies a priori soit par la volonté de l’humain, soit par la configuration de la technique. C’est dans ce sens que l’on peut et que l’on doit traiter de dialogue et non de simple interaction. Dans ce dialogue deux processus se développent et se complètent : l’objectivation et le discours. L’activité se traduit en connaissances validées et déposées dans des outils, méthodes et machines (objectivation). Les connaissances mises en œuvre sont littéralement racontées et commentées par les humains dans les différentes situations qu’ils rencontrent au sein de l’organisation (discursif).
Enfin, dans une formation dialogique hommes-machines, il s’agit de travail collectif et coopératif. C’est-à-dire que les connaissances prennent sens pour un ensemble de salariés qui coopèrent à la production d’un même bien ou service.
La gestion des connaissances prend ainsi trois formes (Poitou, 1996, p.7) :
- Un état actif : les connaissances sont engagées dans des actes productifs,
- Un état inerte : les connaissances sont disponibles dans leurs dépôts,
- Un état de transition : les connaissances sont converties de connaissances inertes en savoirs productifs.
La méthode 3A a pour ambition d’identifier les connaissances inhérentes à un poste de travail, d’enregistrer les pratiques de gestion et de les mettre à disposition des intervenants potentiels.
Pour cela il faut choisir un observateur-apprenti et un praticien. Il est nécessaire qu’une distance optimale existe entre les deux personnes (suffisamment proches dans leurs activités respectives et suffisamment différents dans leur expérience afin de susciter la curiosité de l’observateur).
Après avoir été formé aux techniques d’observation, d’interview et de description, l’observateur assiste à la conduite du praticien et enregistre ses actions. On lui demande de tenter d’accomplir les activités du praticien de manière à ce que l’activité normale puisse avoir lieu.
Ensuite, l’observateur doit faire la démonstration qu’il peut accomplir les activités qu’il a enregistrées. Le praticien assiste au déroulement des actions de l’observateur et peut se prononcer sur la qualité de la reproduction. Ces deux personnes sont donc dans une relation de formateur à apprenti.
La validation est double : elle atteste d’une part que l’apprenti est en capacité d’apprendre à partir de l’observation et qu’il peut reproduire les actions nécessaires à la production ; elle atteste également que le praticien est en capacité d’expliciter son activité de manière efficace.
Dans un troisième temps, l’observateur-apprenti est invité à rédiger un document décrivant les connaissances qu’il vient d’acquérir. Un troisième membre de l’entreprise est sollicité de réaliser les opérations décrites dans le document sur la seule base de la lecture de ce dernier. L’exécution correcte de la tâche, à la satisfaction du praticien, valide empiriquement et localement la description rédigée par l’observateur-apprenti. Un tel enregistrement technographique pourra être versé à la documentation existante de l’organisation (Poitou, 1996, p. 12-13).
La méthode 3A est porteuse de plusieurs enseignements.
Les connaissances sont indissociables de la place où elles sont utilisées. Il faut traiter à cet effet de réalité sociale des connaissances. Les connaissances prises en compte par la méthode ne font pas l’objet de représentations élaborées dans des formalismes généraux élaborés par des analystes extérieurs à l’entreprise, mais de descriptions établies dans les termes de l’organisation, avec pour critère de validation leur bonne transmission en interne (validation empirique et locale). Cette procédure a pour but :
- de ne pas introduire dans les documents d’autres lexiques spécialisés que ceux de la base technologique étudiée, c’est-à-dire ceux qui ont cours dans la langue des praticiens de l’entreprise ;
- de garantir la validité locale et historique des définitions ;
- de conserver les particularités significatives de la syntaxe propre aux praticiens.
3.2. La méthode MASK
La méthode MASK a été conçue par Jean-Louis Ermine qui est un spécialiste d’ingénierie des connaissances.
Il s’agit d’une méthode dédiée à la modélisation des connaissances avec pour objectif de faciliter la transmission entre différents partenaires. Elle s’intéresse à l’existence de la connaissance en tant que telle, sa représentation formelle, son référencement scientifique et technique et sa capacité à faciliter l’innovation. Il s’agit d’une méthode qui favorise l’introduction de nouveaux acteurs dans le processus de transfert des connaissances.
Elle repose sur deux principes fondamentaux : toute organisation détient un savoir organisationnel en propre et la complexité de ce savoir nécessite une modélisation spécifique (Ermine, 2007).
Le premier principe est qu’une firme détient un « savoir organisationnel », qui se pérennise à travers le temps, via des produits d’information (documents, bases de données, logiciels…) ou via des échanges individuels et/ou collectifs. Se forme ainsi un « Patrimoine de Connaissances ».
Le deuxième principe est que la connaissance organisationnelle est un système complexe, elle n’est donc intelligible et maîtrisable qu’à travers une représentation plurielle qui utilise la modélisation systémique.
Basée sur ces deux principes, la méthode MASK comprend quatre phases.
- L’analyse stratégique du patrimoine de connaissances qui a pour but de repérer les domaines de connaissances qui sont « critiques » dans l’organisation. A cet effet, un audit du patrimoine de connaissances ainsi qu’un plan d’action de préservation et de transfert sont élaborés.
- La capitalisation du patrimoine de connaissances. Cette phase concerne tout domaine de connaissances critique et stratégique, à forte composante tacite, où la partie tacite est essentiellement détenue par des experts identifiés. La capitalisation est le recueil de connaissances auprès des experts, afin de formaliser leurs savoirs non-écrits, en vue de les faire partager à d’autres personnes du même métier, ou exerçant des activités très proches.
- Le transfert du patrimoine de connaissances. A partir du corpus de connaissance élaboré au moyen de la capitalisation pour un domaine particulier, il s’agit de transférer la connaissance à une communauté qui en perçoit l’utilité pour ses pratiques opérationnelles. C’est la véritable problématique du transfert qui se pose ici : comment concevoir des dispositifs de transfert à partir du corpus de connaissances constitué, en fonction de l’objectif, la cible, l’environnement ?
- L’innovation fondée sur les connaissances. Le processus se poursuit avec la capacité de l’organisation à faire évoluer son patrimoine de connaissances dans une perspective stratégique. Ceci implique que toutes les ressources créées dans les phases précédentes puissent être utilisées comme levier pour l’innovation à travers la création de connaissances.
Pour ces quatre phases, MASK utilise des outils qui nécessitent des savoirs particuliers : cartes cognitives (cartes stratégiques, cartes des domaines de connaissance), grilles d’analyses, outils de modélisation de connaissances (phénomènes, tâches, activités, concepts, lignées, historique…), modèles de transfert de connaissances. Les modélisations de connaissance sont rassemblées dans un livre de connaissances qui représente un véritable objet de transfert. L’activité de modélisation et l’élaboration du livre de connaissances sont prises en charge par des sociétés de conseil spécialisées ou bien par des « knowledge managers » employés par l’entreprise.
Mais MASK fait également appel à une expertise particulière pour représenter la connaissance. Il s’agit en fait d’une modélisation de système qui repose sur deux hypothèses importantes (Ermine, 1996, p.20-22) (cf. aussi J-L Ermine : « Une théorie de la connaissance », BourbaKeM, Elément n°2) :
- L’hypothèse sémiotique (ou triangle sémiotique) fait de la connaissance un système de signes. Un signe (tout phénomène perceptible) peut se présenter selon trois dimensions : sa syntaxe (structure, règles de fonctionnement), sa sémantique (le sens, le signifiant) et sa dimension pragmatique.
- La seconde hypothèse (triangle systémique) fait de la connaissance un système dynamique qui peut se représenter en trois dimensions : son existence (structure), sa fonctionnalité (faire) et son devenir (évolution).
Ces deux hypothèses permettent d’élaborer des modèles de connaissances très précis. Ces modèles seront agencés dans le Livre de Connaissances versé à la documentation des métiers de l’entreprise.
Cette activité de documentation peut faciliter le partage d’expérience de certains experts. Mais elle exige une capacité de prise de recul vis-à-vis des activités courantes. Elle nécessite également l’implication des experts ou des salariés non experts dans leur domaine.
De fait, cette activité de représentation et de mise à disposition des connaissances est une activité collective destinée à faire expliciter par un employé, pour d’autres employés, un ensemble de connaissances. Cette activité consomme un temps de travail important. Elle engage l’expert à définir ce qu’il sait de manière inédite. Il est conduit à découvrir ce qu’il sait, à découvrir ce qu’il ne sait pas et connu par d’autres ainsi que ce qu’il pourrait connaître.
En résumé, ces deux méthodes font apparaître le rôle actif de l’apprenant ainsi que la capacité de transmission de l’expert. Un transfert réussi repose donc sur une double compétence : celle de celui qui détient une expertise et qui parvient à la rendre intelligible, celle de l’apprenant qui réalise l’effort de rejoindre cognitivement cette expertise. Sans doute faudrait-il ajouter ici le rôle de l’environnement proche de travail, c’est l’objet de la prise en compte des facteurs facilitant le transfert.
4. Les facteurs facilitant le transfert au sein de l’organisation
Les facteurs qui facilitent le transfert de connaissances sont très nombreux. Leur étude se confond avec celle qui est développée par la théorie des organisations. Les communautés de pratique et les communautés épistémiques tiennent un rôle central dans ce partage des connaissances. Toutefois nous choisissons de développer deux ensembles de processus fondamentaux en la matière : la création conjointe et le soin.
4.1. Les processus de création conjointe de connaissances
Dans les premières conceptions sérieuses du management des connaissances, la question du transfert a représenté une étape importante. Elle a été particulièrement bien documentée par Ikujiro Nonaka. Auteur de très nombreuses études scientifiques, le professeur Nonaka a établi un certain nombre de résultats que l’on peut résumer sous forme de guide pour le transfert ou transmission des connaissances.
Plutôt que de management des connaissances, Nonaka invite à s’intéresser à la création de connaissances et à ses conditions facilitantes. La création de connaissances emprunte cinq grandes étapes. Dans un premier temps, les dialogues entre professionnels (autour de la fameuse machine à café, mais également au cours de sessions de formation, d’audit qualité ou de toute autre rencontre sociale) permettent de partager sans formalisme officiel des connaissances à forte dimension tacite. Dans un second temps des concepts sont créés par ces professionnels, puis ils sont justifiés au terme d’un processus de négociation portant sur le sens et l’utilité (troisième étape). La quatrième étape est celle qui voit la construction d’un archétype qui permet de concrétiser et de rendre tangible le concept. Cet archétype pourra servir de démonstrateur dans différents services afin d’emporter l’adhésion. L’extension de la connaissance s’opère ainsi (cinquième étape) dans l’organisation au moyen de plusieurs dialogues et conversions d’idées en concepts puis en objets.
Pour animer ce processus, des « knowledge activist » peuvent être très utiles. Certains employés ou bien des groupes au sein de l’organisation sont parfois en position pour faciliter la création de connaissances. Il s’agit de reconnaître leur importance et de les promouvoir dans leurs actions. Ces « knowledge activists » jouent trois rôles complémentaires : ils catalysent la création de connaissance en aménageant des espaces d’initiatives, ils connectent les initiatives de création en favorisant des micro-communautés d’invention et ils cherchent à promouvoir les actions de prospective en croisant les activités des différentes micro-communautés.
Avec le modèle SECI (socialization, externalization, combination, internalization) parfois mal interprété car rendu mécanique, Nonaka synthétise les différentes modalités de création et de partage des connaissances. Il formalise quatre grandes modalités de partage entre membres d’une organisation. Pour chacune des modalités, une des deux dimensions de la connaissance (tacite ou explicite) est plus sollicitée que l’autre. Au cours d’une discussion entre deux collègues, les informations échangées permettent de partager des connaissances dans leur dimension tacite (c’est la socialisation). Au cours d’une session de formation, un salarié peut intégrer à son répertoire selon son habitude des connaissances formelles (intériorisation), il peut lui-même se prêter à un recueil d’expertise avec un knowledge manager (extériorisation). Enfin en articulant plusieurs connaissances explicites ou formelles, une équipe de travail peut parvenir à combiner ses connaissances.
Le « BA » représente le dispositif le plus délicat à comprendre pour des occidentaux. « BA » est un idéogramme qui associe l’idée de ce qui soulève (terre et eau) et l’idée de ce qui rend possible. Le concept a été élaboré par le philosophe Kitarô Nishida (1921; 1990). Pour cet auteur, le «Ba» désigne un espace physique où réside un pouvoir caché qui prodigue de l’énergie lorsque l’on s’y plonge. Il peut s’agir d’un lieu, mais il s’agit aussi d’un moment durant lequel se vit un processus dynamique de transformation et d’émergence. Nonaka utilise ce concept afin de mettre en valeur les dimensions spatiale et temporelle de la création des connaissances. Ces dimensions se cristallisent dans la notion de contexte au sein duquel sont autorisés certains types d’interaction. Ce contexte doit être compris au sens de plate-forme de création de connaissance en termes d’espace-temps.
4.2. Le rôle du soin dans les relations
Un auteur important dans le champ de la création des connaissances a collaboré avec Nonaka pour définir l’importance des « knowedge activists ». Il s’agit de Georg Krogh, professeur de management. Von Krogh mobilise la notion de «soin» en s’inspirant lui aussi de travaux philosophiques, définie comme une «attention sérieuse», et comme un «sentiment de présence et d’intérêt à l’autre» (Von Krogh, 1998). La qualité du soin influence directement l’efficacité du transfert.
Il étudie les contextes relationnels, en termes de comportements et d’effets sur la dynamique des connaissances. Ces contextes sont structurés par des processus de management (systèmes d’évaluation du personnel, système d’information) et par un ensemble d’attitudes et de comportements. La qualité des relations qui en résulte oriente les possibilités de partage et de création des connaissances (Simoni, 2012).
Cinq comportements sont retenus pour qualifier le niveau de soin dans les organisations : confiance mutuelle, empathie, aide véritable, indulgence par rapport au jugement et courage. Leur présence caractérise un soin élevé (high-care relationships) et leur absence un soin faible (low-care relationships).
On progresse ainsi dans la conceptualisation du transfert : les connaissances sont intimement reliées aux actions des personnes et le transfert ne peut être envisagé sans étude approfondie du système de relations. Une approche générale du partage des connaissances doit intégrer les moyens humains qui sont consacrés au soin apporté aux relations, ainsi par exemple les managers ont un rôle important à jouer en tant que « knowledge activists ».
L’introduction des contextes relationnels nous rapproche des sciences de la culture et de la communication.
Le transfert des connaissances prend ainsi sa place dans les problématiques plus générales du management. Pour autant, l’analyse du transfert n’est pas close. Car demeure encore l’idée que la connaissance est une chose comme une autre.
5. Limites et perspectives
Les méthodes et facteurs facilitant le transfert présentant des qualités certaines, pour autant ils ne neutralisent pas les difficultés qui persistent toujours au sein d’une organisation en raison des contextes irréductiblement attachés aux connaissances.
5.1. Les limites de contexte
Trois types de difficulté sont souvent identifiés dans la pratique du transfert : la durée et le coût d’identification des connaissances pertinentes au sein de l’organisation peuvent être élevés, le transfert proprement dit d’une unité à l’autre peut s’avérer délicat, enfin une dispersion trop forte des unités en termes culturels peut entraver le transfert.
Une mise en question du transfert a été opérée en profondeur par Tsoukas (1996, 2009). En s’interrogeant sur les processus de création et d’expansion des connaissances proposés par Nonaka et Takeuchi (1995), cet auteur nie toute possibilité de séparer les dimensions tacite et explicite de la connaissance : elles sont associées l’une à l’autre comme dans une tresse.
Selon Tsoukas : « la connaissance tacite n’est pas de la connaissance explicite internalisée comme Nonaka et Takeuchi l’affirment, pas plus que quelque chose qu’une firme pourrait perdre durant une crise comme l’affirme Spender (1996). La connaissance tacite est la dimension nécessaire de toute connaissance, les dimensions tacite et explicite sont inséparables » (Tsoukas, 2009:99).
Selon l’auteur, la connaissance tacite, qui représente le grand enjeu du transfert, n’est justement pas transférable ! Elle ne peut pas être capturée ou traduite dans de l’explicite : Tsoukas nous montre que la question est en fait mal posée puisque la connaissance tacite se manifeste dans ce que réalise l’individu, elle ne se laisse pas manipuler, elle est représentation.
5.2. Une heuristique pour faciliter la transmission : la création dans l’interaction
Une dernière problématique, celle des processus d’interaction qui conduisent à élaborer les connaissances, doit être détaillée. Brassac (1994) développe une méthodologie d’aide à la transmission de l’expérience en utilisant une approche de psychologie sociale des processus cognitifs. Les situations d’application les plus fréquentes sont celles du départ d’un technicien ou d’un ingénieur.
L’acquisition de connaissances est un processus dont deux acteurs au moins ((A)pprenant et (C)onnaissant) sont co-responsables. Ce processus se déploie dans un ensemble d’interactions sociales, constituées des échanges discursifs, des productions gestuelles, et par des manipulations de machines. Pour les acteurs, il s’agit de maintenir ces interactions. Dans ces conditions, il n’existe pas à proprement dit de transfert de connaissances. Il se développe plutôt une construction conjointe de significations ayant vocation à être utilisées et appropriées par A dans l’après-coup de l’acquisition. Afin de faciliter cette appropriation, Brassac développe une méthodologie qui consiste à intégrer le plus grand nombre possible de données du contexte d’interaction. Le recueil du discours n’est pas suffisant, il ne faut pas déconnecter le discours de C et l’appréhension de ce discours par A, il ne faut pas abstraire l’expression de l’expertise de son lieu concret de réalisation, il ne faut pas empêcher les deux acteurs C et A de représenter graphiquement les éléments de travail.
Ainsi on donne l’occasion à C et A d’avoir un rapport direct : rapport aux savoirs, aux hésitations, aux oublis, dépendance aux documents et aux limites. On préserve la possibilité d’interroger, de soulever des incohérences, mettre à jour des conflits et proposer des perspectives nouvelles. Les perspectives de partage, plus que de transfert, sont donc liées au fait que la connaissance est distribuée entre C et les artefacts (documents, équipements, …). Une bonne stratégie consistera alors à privilégier les allers-retours entre les différentes modalités de « recueil » des connaissances (diversité, redondance). Ce qui permet de relever les décalages entre énoncés performatifs et expériences vécues et de produire des recommandations et reformulations pour la performance.
Munis de toutes ces méthodes et études qui nous invitent à la prudence, nous pouvons désormais aborder le transfert des connaissances dans de bonnes conditions.
6. Bibliographie
Brassac C., (1994) “Speech acts and conversational sequencing”, Pragmatics and Cognition, 2, 1: 191-205.
Bresman H., Birkinshaw J., et Nobel R., (1999) “Knowledge Transfer in International Acquisitions” Journal of International Business Studies, 30, 3: 439-462.
Dieng R., Corby O., Giboin A., Golebiowska J., Matta N., et Ribière M., (2000) Méthodes et outils pour la gestion des connaissances, Paris : Dunod.
Ermine J.L., (1996) Les systèmes de connaissances. Editions Hermès.
Ermine J.L., (2007) Management des connaissances en entreprise. Lavoisier. Paris, Hermès Science.
Gulati R., Nohria N. et Zaheer A., (2000) “Strategic Networks”, Strategic Management Journal, 21: 203-215.
Nonaka I. et Takeuchi H., (1995) The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press Inc.
Nonaka I. et Konno N., (1998) “The concept of « Ba: Building Foundation for Knowledge Creation.” California Management Review, 40, 3: 40-54.
Poitou J.P., (1996) « La gestion des connaissances, comme condition et résultat de l’activité industrielle », Intellectica, 1, 22, 185-202.
Simoni G., (2012) « Relancer la dynamique de connaissances dans des contextes relationnels dégradés ». Management & Avenir, 7, 57: 14-36.
Tsoukas H., (2009) “The firm as a distributed knowledge system: A constructionist Approach” in Tsoukas, H, Complex knowledge. Studies in Organizational Epistemology. Oxford University Press: 94-116.
Von Krogh G., Nonaka I. et Ichijo K., (1997) “Develop knowledge activists!”, European Management Journal, 15, 5: 475-483.
Von Krogh G., (1998) “Care in Knowledge Creation”, California Management Review, 40, 3: 133-154.
7. L’auteur
 Claude Paraponaris est économiste. Il est professeur de théorie des organisations et de dynamique cognitive à l’Université d’Aix Marseille et chercheur au Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail, CNRS. L’enseignement et les travaux de recherche de Claude Paraponaris s’intéressent à la structuration des réseaux industriels, à l’organisation du travail et à la création de connaissance. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans des revues à comité de lecture et ouvrages dont » L’entreprise en réseau » avec Gilles Paché. Son orientation de recherche est indisciplinaire, il utilise une approche organologique considérant que l’engagement des sujets dans une activité est intrinsèquement lié aux dispositifs constitués de différentes techniques et de relations sociales dans lesquels ils évoluent. C’est le triangle transductif « social – technique – physiologique ». Il est l’un des membres fondateurs de l’AGeCSO. Par ailleurs, il collabore régulièrement aux travaux d’Ars Industrialis.
Claude Paraponaris est économiste. Il est professeur de théorie des organisations et de dynamique cognitive à l’Université d’Aix Marseille et chercheur au Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail, CNRS. L’enseignement et les travaux de recherche de Claude Paraponaris s’intéressent à la structuration des réseaux industriels, à l’organisation du travail et à la création de connaissance. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans des revues à comité de lecture et ouvrages dont » L’entreprise en réseau » avec Gilles Paché. Son orientation de recherche est indisciplinaire, il utilise une approche organologique considérant que l’engagement des sujets dans une activité est intrinsèquement lié aux dispositifs constitués de différentes techniques et de relations sociales dans lesquels ils évoluent. C’est le triangle transductif « social – technique – physiologique ». Il est l’un des membres fondateurs de l’AGeCSO. Par ailleurs, il collabore régulièrement aux travaux d’Ars Industrialis.
[1] Licence « Creative Commons » (CC-BY-NC-SA) Claude Paraponaris, Projet BourbaKeM, élément n°8, 2015