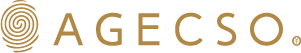Projet BourbaKeM
Elément n°5
Comment définir et gérer l’expert ?
Jean-Philippe Bootz [1]
[Version PDF du texte]
1. Introduction
Les entreprises ont bien intégré que, dans un contexte fait de mutations et d’instabilités, leurs ressources internes constituent un facteur d’avantage compétitif et que, dans ce cadre, le développement des compétences portées par des experts devient un enjeu primordial. Mais dans la plupart des cas on utilise dans les entreprises le terme d’expert sans en maîtriser la définition. Ce dernier est ainsi souvent désigné uniquement sur la base de ses années d’expériences ou de ses compétences techniques. La question du management de l’expertise nécessite ainsi, avant toute chose, de tenter de définir cet acteur particulier. Pour Bootz et Schenk (2009, 2014) ce qui peut globalement définir l’expert est sa double dimension cognitive et sociale.
2. Définition de l’expert
2.1. Dimensions cognitives de l’expert
Il est possible de définir l’expert « en creux », c’est-à-dire en le distinguant d’autres « figures » avec lesquelles il est souvent confondu, à savoir le spécialiste et le savant (Bootz et Schenk, 2009, 2014)
Le spécialiste
Le spécialiste intervient dans le cadre de résolution de problèmes ordinaires dans le sens où il s’agit d’un domaine précis et circonscrit qu’il domine techniquement sur lequel il a pu construire à travers son expérience un apprentissage itératif et répétitif (apprentissage en simple boucle, Argyris et Schön, 1978). Il intervient ainsi dans le cadre d’une « situation simple » pour laquelle la représentation du problème est connue, les connaissances sont stabilisées et la réponse est immédiatement sélectionnée dans un ensemble de réponses préétablies (Dibiaggio, 1999). Au niveau de ses compétences ce sont surtout les savoirs et savoir-faire procéduraux[2] qui seront mobilisés ainsi que les savoirs expérientiels[3]. Son répertoire de ressources est dès lors, essentiellement composé de connaissances tacites (Nonaka et Takeuchi, 1995) et se construit, au fil de son expérience, par des processus de socialisation (échange avec des pairs) et d’intériorisation (réflexion sur ses expériences). Les autres types de ressources et de connaissances sont bien entendu également sollicités mais dans une moindre mesure.
Le savant
Le savant va, quant à lui intervenir, dans le cadre de la compréhension de problèmes généraux et universels. Son objectif principal est d’ordre cognitif puisqu’il vise à créer de la connaissance afin d’alimenter sa communauté scientifique. Ce processus de création de connaissances correspond à un apprentissage en double boucle. Le savant se retrouve face à des « situations-problèmes » ou des « situations complexes » (DiBiaggio, 1999). Dans le premier cas, l’apprentissage consiste à sélectionner une stratégie d’investigation. Dans le second cas, la représentation du problème étant incomplète, il s’agit de mettre en œuvre une démarche d’abduction qui repose notamment sur l’imagination. Le processus d’apprentissage consiste ainsi en la mise en relation de connaissances a priori indépendantes. La compétence du savant repose essentiellement dans sa capacité à mobiliser des connaissances théoriques formalisées par le biais de processus d’extériorisation (traduire des idées, des réflexions sous forme écrite) et de combinaison (diffusion de connaissances par communication). Il nécessite également une maîtrise des opérations intellectuelles nécessaires à la formulation, à l’analyse et à la résolution de problèmes, à la conception et à la réalisation de projets, à la prise de décision, à la création ou à l’invention, donc à ce que Le Boterf (2004) nomme le savoir-faire cognitif.
L’expert
Le cadre d’intervention de l’expert se situe à l’intersection de ceux du savant et du spécialiste. Il intervient en effet dans la résolution de situations problèmes ou complexes qui sont également contextuelles. A la différence du spécialiste il n’agit pas dans un domaine précis et circonscrit mais dans des contextes différents et sans cesse renouvelés. Dans ce cadre, l’expert n’utilise pas de règle, pas de suivi systématique de procédures mais évalue la situation à l’aide de quelques indicateurs pertinents que le cerveau discrimine en un « temps record ». Il opère ainsi une comparaison entre la situation et une classe de situations antérieures puisées de son expérience. A la différence du savant, la compétence de l’expert ne se nourrit pas majoritairement de l’assimilation de connaissances théoriques, mais de la combinaison de ces dernières avec la variété et la richesse des expériences vécues et des actions menées.
Il y a une longue tradition de travaux en psychologie (Coulet, 2014) qui considèrent ainsi l’expert comme un individu possédant des connaissances et/ou des compétences particulières voire extraordinaire en référence à un novice. En particulier, l’expertise cognitive au jeu d’échec est étudiée par les psychologues depuis les années 50 qui soulignent que l’opposition expert/novice s’explique essentiellement par la nature et l’organisation de leurs connaissances et non par leurs capacités cognitives. En situation naturelle, l’approche NDM (Natural Decision Making) souligne que les experts appuient leurs décisions sur leur capacité à apparier la représentation qu’ils ont de la situation à des patterns spécifiques contenus en mémoire décrivant des situations prototypiques (Hutton et Klein, 1999). L’expert se caractérise alors par sa faculté à générer rapidement la bonne option et à éviter ainsi un processus itératif laborieux. Cette faculté constitue un habitus au sens de Bourdieu et renvoi à ce que Le Boterf (2004) désigne par savoir-faire social.
La compétence de l’expert repose ainsi sur des connaissances à la fois tacites (savoir-faire expérientiel, cognitif et social) et explicites (savoir théorique) mobilisés dans le cadre de situations problèmes ou complexes. La construction de son répertoire de ressources repose sur l’interaction entre ces deux types de connaissances par le biais des 4 modes de conversion (SECI) tels que les décrivent Nonaka et Takeuchi.
2.2. La dimension sociale de l’expert
Au centre de l’approche sociologique réside la notion de la relativité de l’expertise en fonction de critères de performances appliqués à un contexte particulier (Ericsson et al., 2006, 2006). Cela conduit à radicaliser la vision de l’expert par rapport aux approches cognitives en considérant que tout un chacun – dans certaines circonstances – peut agir comme un expert. L’expertise est ainsi considérée comme une construction sociale où le statut d’expert est défini par rapport aux non-experts demandeurs d’expertise. L’exercice de l’expertise implique dès lors qu’une personne soit sollicitée qu’elle accepte de répondre à cette demande (Roqueplo, 1997). On ne s’autoproclame pas expert. En particulier, la sollicitation ne peut avoir lieu que si l’expert est crédité d’une légitimité et d’une confiance auprès du demandeur d’expertise. Cette légitimité peut être assise sur une structure institutionnelle formelle (un ordre professionnel, un système de labellisation) ou sur un phénomène social auto-organisé (Bootz et Schenk, 2009, 2014). La légitimité de l’expert peut ainsi être liée à l’institution qui accorde le statut d’expert. Elle possède alors un caractère externe, dans la mesure où étant codifiée, elle peut être appréhendée à l’extérieur de l’institution attribuant le statut d’expert. La sollicitation de ce type d’experts peut dans ce cadre, s’appuyer sur des signaux forts (détention d’un titre ou label). D’un autre côté, la légitimité informelle renvoie à des dimensions tacites de l’expertise et sera difficile à appréhender en dehors du groupe de référence. La sollicitation s’appuie alors sur des signaux faibles (réputation, image).
Par ailleurs, un individu ne sera sollicité comme expert que s’il est crédité d’une confiance de la part du demandeur d’expertise (Ericsson et al., 2006). Confiance à la fois dans les compétences et dans les intentions (Nooteboom, 2002). Cette dernière permet d’expliquer l’exigence de neutralité de l’expert par rapport à son contexte de sollicitation. L’expert ne devrait ainsi pas être directement partie prenante du contexte de sollicitation. La confiance dans les compétences fait, quant à elle, apparaître un paradoxe: comment évaluer des compétences que l’on ne possède pas soi-même ? Autrement dit, la distance cognitive (Nooteboom, 2002) qui sépare l’expert et le demandeur d’expertise est un frein à la construction d’une confiance dans les compétences. Outre les connaissances théoriques, la distance cognitive entre expert et non expert est attribuable aux connaissances tacites. Dès lors, la réduction de cette distance cognitive pourra se faire soit via la socialisation par échanges de savoirs tacites au sein du groupe de référence auquel appartient l’expert, soit par codification de la connaissance experte en dehors de ce groupe. Ainsi dans le cas où le demandeur d’expertise et l’expert se situent dans un même groupe social (par exemple une communauté de pratique), la relation de confiance pourra se construire à travers les interactions selon les modalités propres au groupe social. A l’inverse, lorsque le demandeur se situe dans une position externe au groupe de l’expert, la construction d’une confiance repose sur des signaux forts émis par l’expert ou par son groupe de référence.
3. Gestion de l’expert
L’expertise, produit combiné d’une compétence et d’une légitimité induit qu’une attention particulière doit être portée aux contextes dans lesquels les compétences des experts se développent. Ces contextes ne sont pas homogènes dans la mesure où ils mettent en jeu des structures sociales (communautés) distinctes (Cohendet et al., 2006). Dans ce cadre, la gestion de l’expertise renvoie, à deux catégories de démarches : l’une, tournée essentiellement vers des schémas explicites et relevant d’un mode de management traditionnel, l’autre, centrée autour des activités cognitives reposant sur les communautés autonomes en particulier les CoPs (Bootz et Schenk, 2014).
3.1. La gestion classique des experts
Partant d’une vision de l’expert comme un individu doté de compétences spécifiques, d’une légitimité, et dont l’activité est transversale aux processus de l’entreprise, la GRH des experts pourra se faire selon trois axes. Il convient tout d’abord d’identifier les experts et hauts potentiels, ce qui nécessite une vision claire et globale des niveaux de compétences présents dans les différentes strates de l’entreprise (2.1). Il s’agit ensuite de mettre en place des dispositifs de développement de compétences afin de permettre aux individus de développer l’expertise souhaitée (2.2). Enfin, la gestion des experts doit favoriser l’identification des experts et s’intéresser aux dispositifs de reconnaissance et de légitimation des experts à travers l’organisation (2.3).
Identification des compétences
L’identification des niveaux de compétences et des potentiels constitue une première étape vers une gestion des experts. Pour cela une première démarche possible consiste à mener un raisonnement en termes de métier, d’emploi et de qualification. Si elle constitue un point de repère intéressant pour l’évaluation des compétences, la qualification présente des limites évidentes pour appréhender la compétence de l’expert, qui repose en grande partie sur le savoir-faire acquis par l’expérience individuelle. D’un autre côté, un raisonnement associant compétences et « capacité prouvée » doit être manié avec précaution dans la mesure où les performances individuelles résultent non seulement de la compétence avec laquelle ont été réalisées les pratiques professionnelles, mais également du système sociotechnique dans lequel elles s’exercent. Selon les conditions existantes, à compétences égales, les performances atteintes pourront être différentes (Le Boterf, 2004). Cette première limite liée à la gestion classique des experts est d’autant plus préoccupante que les compétences expertes possèdent un caractère hautement tacite. En effet toute tentative de mettre en place des référentiels compétences –qui constitue un premier pas vers l’identification et l’évaluation des compétences– se trouve confrontée à un problème majeur de caractérisation et de mesure. Ainsi est-on souvent obligé de se contenter de critères d’évaluation généraux de type « (l’expert) est capable de gérer des situations atypiques rencontrées dans le processus de fabrication ».
Face à ces difficultés de construction de référentiels pertinents et d’évaluation des compétences, des dispositifs de type « assessment centers » (centres d’évaluation) ont été mis en place dans les organisations afin d’évaluer les compétences en situation. Ces processus peuvent être efficaces, mais ils sont trop couteux pour envisager de les généraliser.
Développement des compétences
La formation des individus est le premier levier de politique RH mobilisé dans le cadre du développement des compétences (Le Boterf, 2004). Au préalable, l’entreprise doit se doter de dispositifs permettant d’identifier les forts potentiels (employés susceptibles d’acquérir un statut d’expert). Ce stade nous semble particulièrement délicat dans la mesure où il repose sur l’évaluation de compétences (voire d’aptitudes) qui se trouve souvent en dehors du prescrit. Ensuite, il convient de mettre en place des modalités de développement de compétences. D’une part les dispositifs de type tutorat peuvent être établis dans une perspective de transmission des connaissances détenues par les experts. D’autre part, l’acquisition de compétences peut être envisagée ex nihilo comme un processus de construction dans le temps à travers des dispositifs de mobilité ou des parcours professionnels. En effet, l’acquisition de compétences expertes passe nécessairement par l’accumulation d’expériences diversifiées. Seule une multiplication des situations d’action permet à l’individu de prendre du recul sur sa pratique et de développer des connaissances structurantes. L’existence de tableaux de polyvalence dans le cadre de référentiels compétences est utile pour la mise en œuvre efficace de politiques de mobilité. En effet un enjeu central en matière de polyvalence est de trouver un juste milieu entre les objectifs de développement de compétences et les exigences de l’organisation en matière de production. Notons enfin qu’il convient d’éviter l’écueil d’une approche naïve associant mobilité et expérience de manière déterministe.
Gestion de la dimension sociale
Il nous semble essentiel de tenir compte de la dimension sociale de l’expert dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de gestion des experts. En effet nous posons que l’existence de compétences adéquates n’est pas une condition suffisante. Encore faut-il que les personnes détentrices des ressources cognitives soit reconnues pour leurs compétences et considérées comme légitimes. Ces éléments relèvent de la sphère sociale et se construisent de manière progressive –la confiance et la réputation ne se décrètent pas. Néanmoins des actions peuvent permettre d’accélérer le processus d’identification et de légitimation des experts. Les dispositifs de validation des compétences et notamment les labels ou certifications peuvent néanmoins jouer un rôle de facilitation concernant ces aspects. On observe alors un glissement de légitimité : l’expert labellisé est légitime si le label détenu est reconnu et accepté. Ce besoin de légitimité des labels explique sans doute en partie le recours croissant à des organismes certificateurs externes pour la labellisation des personnels internes à l’entreprise. Par exemple, des organismes comme AFAQ-AFNOR proposent des services de certification des compétences, qui vont dans le sens d’une reconnaissance des compétences expertes. Nous pouvons également mentionner les « master black belts » identifiés dans les processus de qualité Six Sigma.
Difficultés liées à la gestion classique de l’expert et processus d’externalisation
La gestion classique de l’expert laisse apparaître les difficultés pour identifier, développer et reconnaître les compétences expertes dues notamment à leur caractère fortement tacite et contextualisé. Ces compétences sont rattachées aux individus et à leur expérience et ne sauraient être résumées par des mesures quantitatives sur la métrique du « niveau de compétence ». Par ailleurs, l’entreprise n’a pas toujours la capacité humaine et financière de développer (dans les délais souhaités) des compétences d’expert en interne. Ensuite, même dans le cas où ces compétences ont été développées en interne, les individus les détenant ne possèdent pas forcément la légitimité qui leur permet d’exercer la fonction d’expert. Dans ces situations, le recours à des experts externes à l’entreprise est une solution envisagée, et qui présente les mêmes perspectives et contraintes que les processus classiques d’externalisation. Il s’agira notamment d’être attentif au risque de disparition de compétences clés et au danger d’une trop systématique « externalisation de la légitimité ».
Face à ces limites, l’utilisation d’une gestion « cognitive » centrée sur les communautés de pratique permet de transférer une partie de la gestion de l’expertise vers les individus et les structures sociales intermédiaires de la firme. Cette opération s’opère à moindre coût étant donnée leur nature auto-organisée. Le revers de la médaille est que les outils RH classiques et maîtrisés s’avèrent partiellement inutilisables. Il s’agit alors d’imaginer de nouvelles voies d’intervention suffisamment dosées pour conserver le couplage subtil entre le caractère auto-organisé des communautés et les impératifs de l’organisation. L’enjeu est de taille : offrir à l’entreprise des perspectives pour l’organisation et le développement de compétences critiques, qui sont intrinsèquement individuelles et situées.
3.2. Gestion « cognitive » de l’expert
L’activité cognitive de la firme se développe essentiellement au sein de communautés de connaissances et dépasse le découpage hiérarchique traditionnel (Cohendet et al., 2006) Ces communautés sont génératrices de compétences individuelles et collectives et constituent, à ce titre, de forts potentiels d’expertise. Dans ce cadre, nous considérons que le manager peut emprunter deux voies pour gérer les experts. Soit, du fait de leur dimension auto-organisée, il pratique une politique non interventionniste (2.2.1) en offrant simplement un contexte organisationnel propice à leur développement autonome. Soit il intervient activement pour coordonner ces communautés et gérer ainsi l’architecture cognitive de l’organisation (2.2.2).
Le non interventionnisme
Dimension cognitive de l’expert au sein des CoPs
Pour Brown et Duguid (1991), les CoPs développent une construction sociale de l’apprentissage et sont un lieu privilégié pour la construction des compétences des experts. En effet constatant l’écart entre le processus prescrit des tâches et les pratiques organisationnelles, les individus cherchent à développer au sein des CoPs une compréhension et une action ancrées dans leur travail quotidien. En participant à une CoP, les individus font ainsi évoluer leurs pratiques de manière très autonome en fonction de ce qu’ils considèrent comme important. Les CoPs sont des lieux où le partage de connaissance et l’apprentissage s’effectuent de manière spontanée et auto-organisée, en s’affranchissant des contraintes et des dispositifs définis par l’organisation. Ainsi les arrangements contractuels classiques laissent la place à un engagement et une participation volontaire des individus (Wenger, 1998). En se focalisant sur les pratiques réelles, sur les problèmes de tous les jours, sur l’évolution du domaine d’intérêt, sur les choses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, les CPs sont ainsi sources de valeurs pour ses membres (Brown et Duguid, 1991). Ces derniers mettent leurs expériences à la disposition de la communauté qui, en retour, leur permet d’améliorer leurs compétences grâce à la somme de connaissances et d’expériences qu’elle a capitalisée. Ils font ainsi évoluer les pratiques de manière très autonome en fonction de ce qu’ils considèrent comme important. Les CPs constituent ainsi un lieu privilégié pour la construction des compétences des experts.
Dimension sociale de l’expert au sein des CoPs
Selon Wenger (1998), l’engagement mutuel qui caractérise les CoPs implique une relation d’entraide entre les participants. Dans ce cadre, la compétence qui consiste à savoir aider et se faire aider est prépondérante. Entre les membres d’une CoP règne ainsi a priori un climat de confiance dans la mesure ils sont amenés a régulièrement partager leurs expériences, leurs objectifs et leurs idées. Les CoPs constituent ainsi un environnement social propice au développement de relations de confiance entre individus et à une légitimation des experts rapidement reconnus au sein de la communauté. Les CoPs sont des structures sociales souvent invisibles de l’extérieur et de ce fait, les experts émergeants au sein des CoPs ne sont pas a priori identifiés en dehors de la structure sociale. On pourrait ainsi considérer que les CoPs sont avant tout des incubateurs de spécialistes. Les membres de la CoP sont en effet centrés sur l’action et la résolution de problèmes concrets et leur sphère sociale d’intervention est clairement délimitée. Cependant une CoP ne se compose pas de niveaux de compétences homogènes (Cohendet et al., 2006). Elle comprend en effet à la fois des nouveaux entrants (à sa périphérie), des praticiens confirmés (au niveau intermédiaire) et enfin les pairs (en son coeur). Ces derniers jouissent d’une légitimité et d’une réputation leur permettant d’être sollicités par d’autres membres de la CoP afin de résoudre des problèmes complexes et sont dès lors considérés comme des experts en interne. Les experts issus des CoPs se distinguent toutefois de ceux qui émergent des structures hiérarchiques classiques par rapport au processus de construction de ses compétences (learning-by-doing vs. formation) et du type de reconnaissance (hiérarchique et codifiée vs. communautaire et tacite).
Facilitateurs de CoPs
La plupart des auteurs se rejoignent pour prétendre que ce n’est pas parce que les CoPs ont tendance à émerger naturellement que l’organisation ne peut influencer leur développement. Si, certaines CoPs peuvent émerger et se développer sans que l’organisation les reconnaisse officiellement, d’autres en revanche ont besoin d’un réel soutien institutionnel pour exister. Ce soutien doit toutefois être suffisamment bien « dosé » pour ne pas remettre en cause le caractère auto-organisé des CoPs.
Le premier rôle que peut jouer l’organisation pour soutenir les CoPs est de « légitimer » la participation de ses membres. Les tâches journalières sont souvent considérées comme plus importantes et plus urgentes que la participation à une communauté même si cette dernière est jugée intéressante par l’organisation. C’est pourquoi il est nécessaire de donner à ses membres le temps nécessaire à leur participation active. L’inscription de cette participation aux communautés dans le planning et dans le budget de l’entreprise contribue fortement à cette légitimation. Elle passe également par le discours institutionnel qui doit intégrer cette dimension cachée de la vie organisationnelle. A ce titre, le simple fait d’introduire le terme « communauté de pratique » dans le vocabulaire de l’organisation peut avoir des effets positifs.
Le management des communautés
Une politique non interventionniste se heurte à un certain nombre de risques. D’un point de vue organisationnel, des biais peuvent apparaître dans le cas de CoPs isolées. Leur fort ancrage identitaire peut être source d’enlisement dans leur routine, de rigidités. Cela peut même être propice à la discrimination vis-à-vis d’autres communautés ou d’incompatibilité vis-à-vis du fonctionnement hiérarchique des organisations (Cohendet et al., 2006). En cas d’absence de prise en compte des CoPs par le manager, ces communautés –grâce à leur nature auto-organisée– sont capables de se développer tout de même, mais resteront invisibles et non exploitées au niveau du potentiel d’expertise. On risque ainsi d’aboutir au sein de ces CoPs à une forme d’hyperspécialisation du fait de la non-sollicitation extérieure à la base de la dimension sociale de l’expertise. Pour éviter ces biais, il est nécessaire de tenter de mailler les CoPs entre elles et de les piloter.
Le maillage entre CoPs
Le maillage entre CoPs peut s’effectuer soit par l’activation d’« objets frontière » soit en faisant appel à des acteurs assurant l’interface entre communautés (Wenger, 1998 ; Brown et Duguid, 1998)
Les objets frontière sont des objets physiques ou symboliques appartenant à plusieurs pratiques. Ils sont capables, à ce titre, de voyager entre différentes communautés. Afin d’assurer son rôle de médiateur, l’objet frontière doit être suffisamment modulable pour s’adapter aux contraintes locales et suffisamment robuste pour maintenir une identité commune entre les communautés. Les contrats, en contribuant, à travers la négociation, à la convergence de groupes différents autour d’une signification commune acceptée par tous, jouent ce rôle d’objet frontière. C’est également le cas des plans, des documents ou des systèmes d’information. La mise en place d’objet frontière facilite ainsi la reconnaissance et l’échange entre membres de CoPs différentes et leur offre ainsi la possibilité d’ouvrir leur expertise à une sphère sociale plus large que celle de leur propre communauté. Ainsi leur potentiel d’expertise a davantage de chance de s’exprimer à travers des sollicitations externes. Les CoPs, en étant ainsi reliées entre elles, passent du statut d’incubateur de spécialistes à créateur d’experts.
Le lien entre différentes communautés de pratiques peut également être assuré par des acteurs interface pouvant prendre la forme de « traducteurs » (translators) ou de « courtiers de connaissances » (knowledge brokers). Les traducteurs ont pour rôle d’établir une communication entre différentes CoPs ayant chacune leur jargon, leurs centres d’intérêt. Cela requiert à la fois une connaissance suffisante des CoPs dont il est chargé d’assurer les liens (sphère cognitive) et une confiance importante de la part des membres des CoPs (sphère sociale). La compétence de ce traducteur étant rarement présente au sein des organisations, ces dernières se tournent souvent vers l’externalisation (consultants) pour acquérir cette forme d’expertise.
Le rôle du courtier de connaissances, à la différence du traducteur, implique une participation active plutôt qu’une médiation passive. Il repose sur une multi-appartenance facilitant la circulation des connaissances. Le courtier constitue ainsi un expert au sein des différentes communautés dans lesquelles il intervient dans la mesure où pour mener à bien son activité il doit bénéficier d’une forte légitimité de la part des membres des CoPs dans lesquels il intervient. La transversalité de son activité et la légitimité sociale qui lui est attachée fait qu’il nourrit symbiotiquement les dimensions cognitives et sociales de l’expertise.
Le maillage entre les CoPs et les autres communautés d’apprentissage
Au-delà du maillage entre CoPs, le manager doit, en matière de gestion d’experts, s’interroger sur l’interaction entre les CoPs et les autres communautés d’apprentissage présentent dans l’organisation. En effet, l’organisation n’est pas uniquement une constellation de communautés de pratique mais constitue une « communautés de communautés d’apprentissage hétérogènes » (Cohendet et al., 2006). Dans ce cadre il s’agit d’activer des lieux d’interactions sociales, des plates-formes cognitives favorables à la construction et à l’expression des potentiels d’expertise des membres des CoPs. Le manager peut, par exemple dans cette optique de gestion de l’architecture cognitive de la firme, décider de mettre en place régulièrement des groupes projets dans les domaines de l’innovation ou de la qualité en s’appuyant pour la composition de ses groupes sur des représentants de communautés de pratique. Ces derniers seront ainsi sollicités en dehors de leur sphère d’origine sur des sujets transversaux dans le cadre de processus d’aide à la décision.
En dehors du cadre finalement classique des groupes projets, le manager peut aussi ponctuellement sur certains sujets de préoccupation de l’entreprise, décider de recourir à l’activation de communautés épistémiques (Cowan et Foray, 2000). Il peut s’agir par exemple d’une démarche prospective menée en interne, d’un groupe de réflexion sur les risques auxquels est exposée l’organisation ou bien de planification stratégique. L’idée ici est également d’utiliser l’activation de ce type de structure sociale pour solliciter l’expertise de membres de CoPs différentes.
Les communautés de pratique pilotées
Du fait de leur caractère auto-organisé, les CoPs ont pendant longtemps été considérées par le management comme des structures non identifiées. Récemment cependant, les entreprises cherchant à nourrir et à développer de manière active de telles communautés se sont multipliées : Siemens, British Petroleum, IBM, le Conseil de l’Europe, GDF-Suez, ou Schlumberger. Pour les organisations s’engageant dans une telle démarche, la difficulté réside dans le pilotage des communautés. Il est en effet nécessaire que celles-ci produisent des éléments en phase avec les préoccupations de la firme, sans pour autant que soit étouffée la dimension auto-organisée qui fait leur intérêt. Dans ce cadre, le problème à surmonter est de soutenir les activités de la communauté sans remettre en cause son fonctionnement. Il est nécessaire dans ce cadre de parvenir à « piloter l’auto-organisation ». La littérature met en avant deux mécanismes permettant de dépasser cet oxymoron : la fixation d’objectifs et de livrables et une gouvernance fondée sur les rôles de manager et de sponsor (Probst et Borzillo, 2007 ; Borzillo et al., 2008 ; McDermott et Archibald, 2010).
Le sponsor, en général une personne occupant un niveau hiérarchique élevé, a pour rôle de garantir que la communauté dont il a la charge dispose des ressources et du temps nécessaires à son fonctionnement tout en veillant à ce que l’activité de la communauté reste en ligne avec celle de l’organisation. Le manager a quant à lui en charge d’assurer une coopération effective et un renforcement des liens de confiance entre les membres pour leur permettre d’échanger des connaissances via notamment l’aménagement de l’espace de travail et la mise à disposition d’outils informatiques (McDermott et Archibald, 2010). Il est chargé de donner « une âme » à la communauté en participant activement à la construction de son identité.
Les communautés pilotées regroupent en pratique des réalités multiples. Il existe en effet des éléments de diversification importants. Une synthèse récente (Bootz, 2014) permet l’identification deux types de CoPPs (les CoPPs stratégiques d’exploration / CoPPs opérationnelles d’exploitation). Les communautés stratégiques se centrent sur l’échange continu d’idées innovantes en favorisant le développement et le partage de pratiques et de connaissances à travers les divisions de l’organisation. Elles correspondent à ce titre à ce que Dupouet et Barlatier (2011) désignent par CoPP d’exploration.
Les communautés opérationnelles (Probst et Borzillo, 2007, 2008 ; Borzillo et al, 2008) se composent d’experts qui se transfèrent des pratiques de nature technique et opérationnelle afin d’optimiser leurs activités quotidiennes. Ces communautés sont clairement orientées exploitation (Dupouet et Barlatier, 2011) dans la mesure où elles se centrent sur l’amélioration des façons de faire existantes.
4. Conclusion
Dans une économie fondée sur les connaissances, la gestion des connaissances devient un enjeu stratégique fondamental. Dans ce cadre, les ressources humaines ne peuvent être considérées comme une simple addition d’opérateurs ou d’exécutants mais comme un collectif d’acteurs qui mobilise sans cesse diverses formes de savoirs, de compétences et sont dans des situations créatives. Parmi ces acteurs nous avons souligné le rôle central tenu par les experts. Les dimensions cognitives et sociales à travers lesquelles nous appréhendons les experts nous conduisent à proposer de les gérer non seulement via les outils RH standards mais aussi via des structures cognitives auto-organisées en particulier les communautés de pratique.
5. Bibliographie de base
Argyris, C. et Schön, D., Organizational learning: a theory of action perspective, New York, McGraw-Hill, 1978.
Bootz J.P. (2015), « Comment concilier auto-organisation et contrôle au sein des communautés de pratique pilotées? : une scoping review », Management International, 19(3), 2015, 15-30.
Bootz J.P., Schenk E., « L’expert en entreprise : proposition d’un modèle définitionnel et enjeux de gestion », Management et avenir, n° 67, janvier 2014.
Bootz J.P., Schenk E., « Comment gérer les experts au sein et en dehors des communautés ? », in Bootz J.P., Kern F., Les communautés en pratique : leviers de changements pour l’entrepreneur et le manager, Traité Management et Gestion des STIC, Hermès Science Publications, Lavoisier, mai 2009.
Bootz J.P., Lievre P., Schenk E. (2015), “Solicitation of experts under uncertainty : the case of a polar exploration”, Journal of Knowledge Management, forthcoming, 2015.
Cohendet P., F. Créplet et O. Dupouët (2006), La gestion des connaissances : Firmes et communautés de savoir, Paris.
Dibiaggio L., « Apprentissage, coordination et organisation de l’industrie. Une perspective cognitive », Revue d’Economie Industrielle, 88, 1999,
Dupouet O., Parlatier P.J. (2011), « Le rôle des communautés de pratique dans le développement de l’ambidextrie contextuelle : le cas GDF SUEZ », Management International, vol.15, n°4, p. 95-108.
Ericsson K. A., Charness N., Paul J. Feltovich P.J., Hoffman R.R., The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance, Cambridge University Press, 2006.
Nooteboom B., Trust : forms, foundations, functions, failures and figures, Cheltenham, Edward Elger, 2002.
Probst G., Borzillo S. (2008) « Why Communities of Practice succeed and why they fail », European Management Journal, n° 26, p. 335-347.
Wenger E. (1998), Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity, Cambridge, MA : Cambridge University Press.
 [1] Jean-Philippe BOOTZ a obtenu son doctorat en Sciences de Gestion en 2003 au CNAM Paris sous la co-direction de Patrick Cohendet et de Michel Godet. Il est aujourd’hui Maître de Conférences à l’Ecole de Management de Strasbourg où il occupe notamment la fonction de responsable du master MAE (Management et Administration des Entreprises) et de la Chaire de management des connaissances. Rattaché au laboratoire HuManiS (EA 7308), ses recherches reposent sur l’articulation entre management des connaissances, prospective stratégique et gestion des ressources humaines. Ses travaux se centrent en particulier sur les notions de communauté de pratique et d’expert. Auteur de nombreuses publications dans des revues nationales, internationales et dans des ouvrages collectifs, il est également membres de plusieurs communautés scientifiques, en particulier de l’AGRH, de l’AIMS et d’AGECSO.
[1] Jean-Philippe BOOTZ a obtenu son doctorat en Sciences de Gestion en 2003 au CNAM Paris sous la co-direction de Patrick Cohendet et de Michel Godet. Il est aujourd’hui Maître de Conférences à l’Ecole de Management de Strasbourg où il occupe notamment la fonction de responsable du master MAE (Management et Administration des Entreprises) et de la Chaire de management des connaissances. Rattaché au laboratoire HuManiS (EA 7308), ses recherches reposent sur l’articulation entre management des connaissances, prospective stratégique et gestion des ressources humaines. Ses travaux se centrent en particulier sur les notions de communauté de pratique et d’expert. Auteur de nombreuses publications dans des revues nationales, internationales et dans des ouvrages collectifs, il est également membres de plusieurs communautés scientifiques, en particulier de l’AGRH, de l’AIMS et d’AGECSO.
[2] les savoirs procéduraux décrivent des enchaînements explicites d’opérations et d’actions orientées vers la réalisation d’un but déterminé alors que les savoir-faire procéduraux passent par l’expérience pratique, l’apprentissage et l’entraînement et permet de transformer le savoir en une forme exécutable (Le Boterf, 2004).
[3] Savoir qui s’acquiert dans le feu de l’action, par l’expérience, par la pratique répétée du traitement « à chaud » des problèmes professionnels et qui prend en compte « ce qui est particulier, local, temporel et oral dans la situation d’action ».